« Si ça arrive à Istanbul, on y perdra la vie. Moi je mourrai, c’est sûr. Je me dis que j’ai déjà bien vécu, c’était sympa la vie. » C’est ainsi que Talha, sourire provocateur aux lèvres, nous livre ses prédictions vis-à-vis du tremblement de terre attendu à Istanbul.
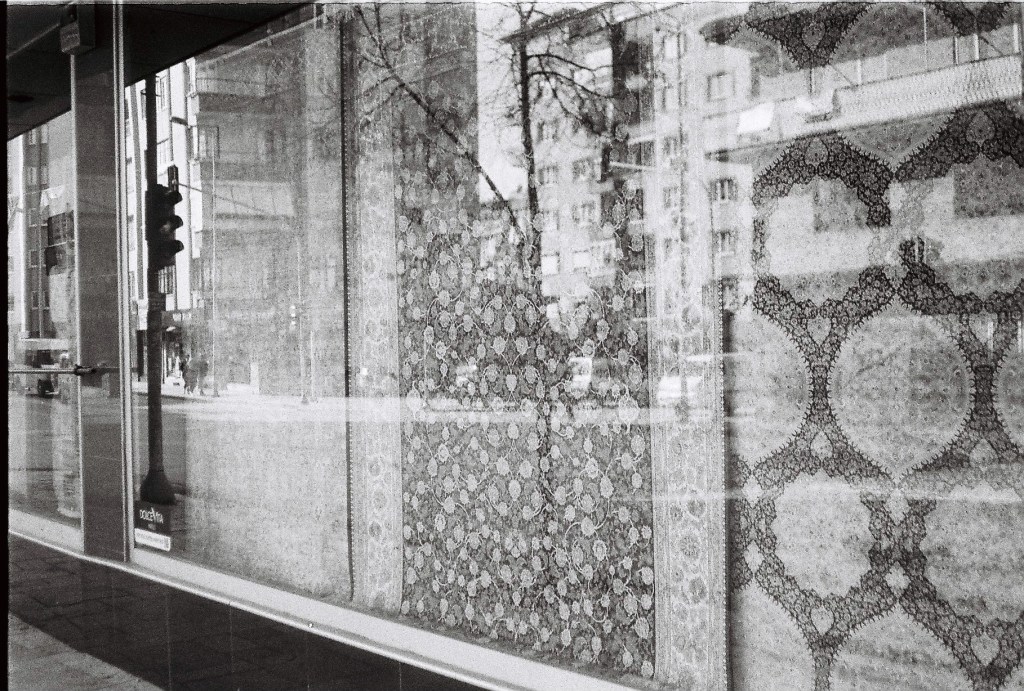
Avant d’être attendu, le tremblement de terre a été annoncé par les sismologues. 67% de possibilité qu’un tremblement de terre majeur intervienne dans la région d’Istanbul dans les dix prochaines années. Jusqu’ici le risque était impalpable. Il aurait d’ailleurs pû être atténué si les décideurs avaient voulu préparer la ville à la catastrophe. Mais Istanbul est en partie construite sur du sable, des couches friables, trop proche de la mer, cernée par des barrages hydroélectriques qui laisseront s’épancher des fleuves entiers s’ils venaient à lâcher.
Puis il y a eu, la semaine dernière, l’imprévu. Le coin de la plaque tectonique que les sismologues ne regardaient pas. À des centaines de kilomètres d’ici, autour de Gaziantep, Atay, Kilis et du côté syrien Alep, Afrin. Deux secousses sismiques à quelques heures d’intervalle, d’une ampleur impressionnante et les suivantes ont ravagés une région de milliers de kilomètres carrés. Pendant la nuit, la secousse a piégée des milliers d’habitants qui ne se sont jamais réveillés, et d’autres qui ont ouvert les yeux sous des tonnes de gravas.
Usame, notre hôte à Istanbul, fulmine de colère et de tristesse. Il le sait, beaucoup auraient dû s’en sortir si les choses avaient été organisés en amont, si le parti au pouvoir (AKP) n’avait pas ralenti l’assistance sur place pour des raisons politiques de concurrence avec le parti local. Il en a les larmes aux yeux en nous en parlant le soir assis sur le tapis persan de son salon. Plusieurs de ses amis ont perdu des proches sur place. Usame il veut aider… Il prépare avec sa troupe de théâtre un spectacle pour les gens de l’est qui ont besoin de réconfort et pour récolter de l’aide alimentaire. C’est ce qu’il sait faire, raconter des histoires.

Le regard d’Usame est sombre depuis les nouvelles de la catastrophe. À Istanbul personne ne vit sans penser aux camarades de Gaziantep sous les décombres. Mais Istanbul se rappelle aussi que les sismologues regardaient plutôt de leur côté. Dans le quartier Syrien d’Istanbul, un ami libanais nous conseille de quitter la ville, il ne fait pas bon trainer ici. Istanbul pourra-t-elle encore dormir sur ses deux oreilles ? Pourra-t-elle de nouveau prendre le risque d’aller au lit sans vérifier que ses affaires sont prêtes à être ramassées en un instant, avant de dévaler les escaliers quatre à quatre pour descendre dans la rue ?
Talha a peut-être raison de se résigner, d’accepter de vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier d’une vie bien vécue.
Quelques jours avant le tremblement de terre de Gaziantep ça avait été la diplomatie internationale qui avait mis un coup au moral stambouliote. Des nationalistes suédois avaient voulu répondre au véto de la Turquie contre l’entrée de la Suède dans l’OTAN (en processus accéléré pour se prémunir d’une menace Russe) en brûlant des corans. Oui c’est dur à suivre, une crise diplomatique en trois temps, comme sortie d’un mauvais roman de gare. N’empêche que cette provocation des nationalistes suédois a fait craindre une réplique d’intégristes religieux turcs à l’égard de touristes ou d’expatriés européens à Istanbul. Bref le personnel de plusieurs ambassades a déserté et les grands bâtiments et les commerces dans les quartiers européens sont bardés de militaires turcs à cran, pour les protéger d’une menace invisible.
La cybersurveillance est de mise à Istanbul. Chacun se sait surveillé, guetté et l’accepte. On connaît ça aussi, venant de France. La recette d’une ambiance acide, mélange de résignation, de peur, de contrôle prend forme à Istanbul. On ne peut s’empêcher de penser que l’incroyable effort de protection étatique et militaire des lieux de consommation et de tourisme pourrait être usé à des fins humanitaires dans L’Est du pays.
Et nous dans tout ça ? On a traversé l’Europe d’est en ouest pour arriver en Turquie, antichambre de l’Asie. Le décalage de notre place ici on le sent plus que d’habitude. On s’en veut presque de finalement aimer Istanbul. De parcourir les bazars, le jardin des mosquées, les quais du Bosphore en se disant qu’Istanbul est une des plus belles villes qu’on aura l’occasion de voir dans notre vie. Trouver une ville belle c’est déjà une posture de touriste. S’il y avait pas la moitié du monde qui rêverait de venir à Paris, je n’aurai pas commencé à considérer cette ville retravaillée par le pouvoir bourgeois il y a deux siècles comme attrayante. On trouve jolies les couleurs des mosquées qui ont une signification bien plus profonde et incarnée pour les croyant qui viennent y prier, on trouve bon les plats syriens que l’on découvre pour la première fois au quartier de Fathi alors que nos voisins de tables y retrouvent les saveurs de leur cuisine maternelle, venues d’un pays qu’ils ont dû quitter.
La voix tremblante d’Usame nous disant que la Turquie est au bord du gouffre, le regard tendu de l’épicier qui regarde le flash info à la télé en pesant notre sac de noix, donnent une saveur particulière à nos souvenirs de la ville.
Dans l’esprit du voyageur un lieu n’est pas vécu sur le long terme, il est associé à une époque, une saison, une temporalité… Pour nous İstanbul restera un mois de janvier neigeux, que le froid, les armes des militaires et les flash info font trembler.

































